
Un pouvoir de Transition n’est pas un régime de satisfaction immédiate des revendications sociales
Un régime de Transition doit avoir une vision politique responsable : il s’agit de penser le long terme plutôt que de céder à la tentation de “résoudre” des problèmes structurels en quelques mois.
Dans les périodes de Transition, la population espère souvent des miracles rapides : baisse des prix, retour de la stabilité, amélioration visible du quotidien. Pourtant, un pouvoir de Transition, par essence, n’a pas vocation à tout résoudre. Un pouvoir de Transition n’est pas un gouvernement de gestion courant. Ce n'est pas un gouvernement de satisfaction immédiate des revendications sociales.
La Refondation n’est pas une simple période d’attente, mais un moment constituant, une parenthèse utile, où la société réécrit les règles de sa propre souveraineté. Sa vocation première est donc plus profonde : mettre en place les fondations d’un système politique et institutionnel qui garantira la stabilité, la justice et la démocratie pour les générations à venir.
* réparer les institutions,
* restaurer la confiance,
* redéfinir les règles du jeu politique,
* créer les conditions d’une gouvernance durable et légitime.
La Refondation engagée à Madagascar s’inscrit dans cette logique. Elle ne se limite pas à répondre aux urgences du moment, mais cherche à corriger les causes profondes des crises à répétition qui ont fragilisé notre Nation. Refonder, c’est bâtir des institutions solides, redonner sens à la responsabilité publique et placer l’intérêt général au cœur de l’action de l’État.
Mais l’objectif n’est pas seulement de réparer, mais aussi et surtout de prévenir. Prévenir la concentration du pouvoir, prévenir la corruption, prévenir la fragilité des institutions. C’est en posant des bases claires – celles de la transparence, de la redevabilité et du respect de la loi – que nous assurons un avenir durable à la République.
Les risques de dérives
Il est vrai que le juste équilibre est plutôt délicat. La Transition, qui doit se concentrer sur les fondations institutionnelles, se heurte à un paradoxe politique : les populations, fatiguées des crises, attendent des résultats concrets immédiats (prix, emploi, sécurité, infrastructures). Ces attentes contradictoires ne sont pas sans danger.
Si le pouvoir de Transition cède à la pression populiste, il risque de rater sa vocation historique. Mais s’il se limite au travail de fond sans communiquer efficacement, il peut perdre la légitimité populaire.
Ainsi, cette mission, par sa nature exceptionnelle, comporte des risques de dérive qu’il convient d’identifier et de prévenir avec lucidité.
1. Le risque d’une Transition sans fin.
Une Transition doit être clairement délimitée dans le temps. Lorsqu’elle s’éternise, elle perd son sens et sa légitimité. L’absence d’échéances précises peut nourrir la méfiance et transformer un pouvoir transitoire en régime de fait, détourné de son objectif initial de reconstruction institutionnelle. Au risque de heurter les panafricanistes, le Burkina Faso n’est pas un modèle.
Le 14 octobre, devant le palais d’Ambohitsorohitra, les chefs du Comité de Refondation nationale a annoncé que le régime de Transition durera entre 18 et 24 mois. Il faut bien confirmer ce calendrier, gage de crédibilité, car les autres déclarations faites à ce moment-là ont été annulées après visionnage du VAR, la vidéo des arbitres que sont les membres du HCC, pour utiliser une expression footballistique, le président Michaël Randrianirina étant un grand amateur du ballon rond.
2. La personnalisation du pouvoir.
La Transition n’appartient à personne : elle appartient à la Nation. Toute tendance à la concentration du pouvoir ou à la mise en avant d’intérêts personnels contredit l’esprit même de la Refondation. L’absence annoncée d’effigie du président de la Transition dans les bureaux administratifs est déjà un bon point.
D’autre part, un pouvoir de Transition ne doit jamais devenir un tremplin politique, mais demeurer un service désintéressé rendu à l’État et au peuple. C’est pourquoi, tous les participants au régime de Transition doivent s’engager à na pas se présenter aux élections post-Transition.
3. La confusion de mission.
La vocation d’un régime transitoire est de réformer, pas de gouverner à long terme. Lorsqu’il cherche à gérer les affaires courantes comme un gouvernement ordinaire, il s’éloigne de sa mission fondatrice. La Transition doit rester un moment d’architecture institutionnelle, non un exercice de pouvoir permanent. Ainsi, le pouvoir de Transition doit éviter de prendre des décisions que vont engager la Nation dans la durée.
Ne pas promettre dans l’euphorie, ne pas décider dans l’exaspération. Le moindre recrutement et la hausse d’une quelconque indemnité comportent des implications budgétaires à long terme que le pouvoir de Transition se doit d’abstenir de promettre, même si cela lui attire une adhésion populaire.
C’est tout à l’honneur des chefs du comité de Refondation de chercher une solution pour faire marcher les 4 groupes d’Ambohimanambola pour produire 20 MW afin de soulager la population contre le délestage. Mais il faut savoir qu’il manquera encore 30 MW et que le tout ne pourra être comblé définitivement que par la construction de barrages hydroélectriques.
Cela dit, le barrage de Volobe sera (peut-être) opérationnel d’ici 2028, comme annoncé par Zandrilahitaloha - en fait il aurait déjà dû l’être depuis 2020, mais on reste dubitatif sur le calendrier de celui de Sahofika, lequel dépend, entre autres, de la construction par l’État de 100km de route conduisant vers le site !
Enfin, le Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA) n’est pas Madagascar. Dans les discours, on n’enregistre aucun plan pour mette un terme au délestage dans les régions, encore moins pour harmoniser le coût du kilowattheure entre la capitale, où l’on pratique une vente à perte, et les provinces où l’électricité coûte pratiquement 4 fois plus cher
4. Le risque d’exclusion.
Une Refondation durable ne peut être le fait d’un seul groupe. Si certaines forces politiques, sociales ou régionales se sentent écartées du processus, les divisions anciennes risquent de resurgir. Une Transition réussie repose sur l’écoute, la concertation et la participation inclusive, conditions indispensables pour restaurer la cohésion nationale.
Les crises qui se sont succédé à Madagascar n’ont pas opposés que les Ratsirakistes et les Zanak’i Dada. Il y a aussi les Zanak’i Dadah, le IRMAR pour faire simple, qui ne doivent pas être exclus des assises nationales prévus se tenir bientôt. Dans ce contexte, le principal objet de ces assises doit être la signature d’un accord politique garantissant l’inclusivité et le respect des libertés fondamentales, garanti et suivi par un comité de médiation national, et non un calendrier des élections dont l’arrêtage est une prérogative du gouvernement ou - pire, une nouvelle Constitution dont la première des qualités est de ne pas être issue de palabres populaires, mais rédigée par des gens de haute qualité et visionnaires
5. Le risque d’opacité et de perte d’exemplarité.
La Transition doit incarner l’exemple. Toute manque de transparence, tout abus de pouvoir ou déni de redevabilité mine la confiance du peuple. : dans la gestion, dans le comportement, dans la parole donnée.
Après le je t’aime moi non plus avec la Constitution et les valses des diplomates à Iavoloha, l’opinion public ne sait plus sur quel pied danser. D’autant plus que certains n’hésitent pas à annoncer la prétendue acceptation d’une base militaire.
Et si, un jour, des mécontents de la politique de la Transition reviennent descendre dans la rue, la place de la Démocratie à Ambohijatovo, voire la place mythique du 13 mai, leur seront-elles ouvertes ou auront-ils droit à leur dose quotidienne de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc ? Les dirigeants de la Transition doivent montrer, par leurs actes, que la Refondation qu’ils prônent commence par eux-mêmes.
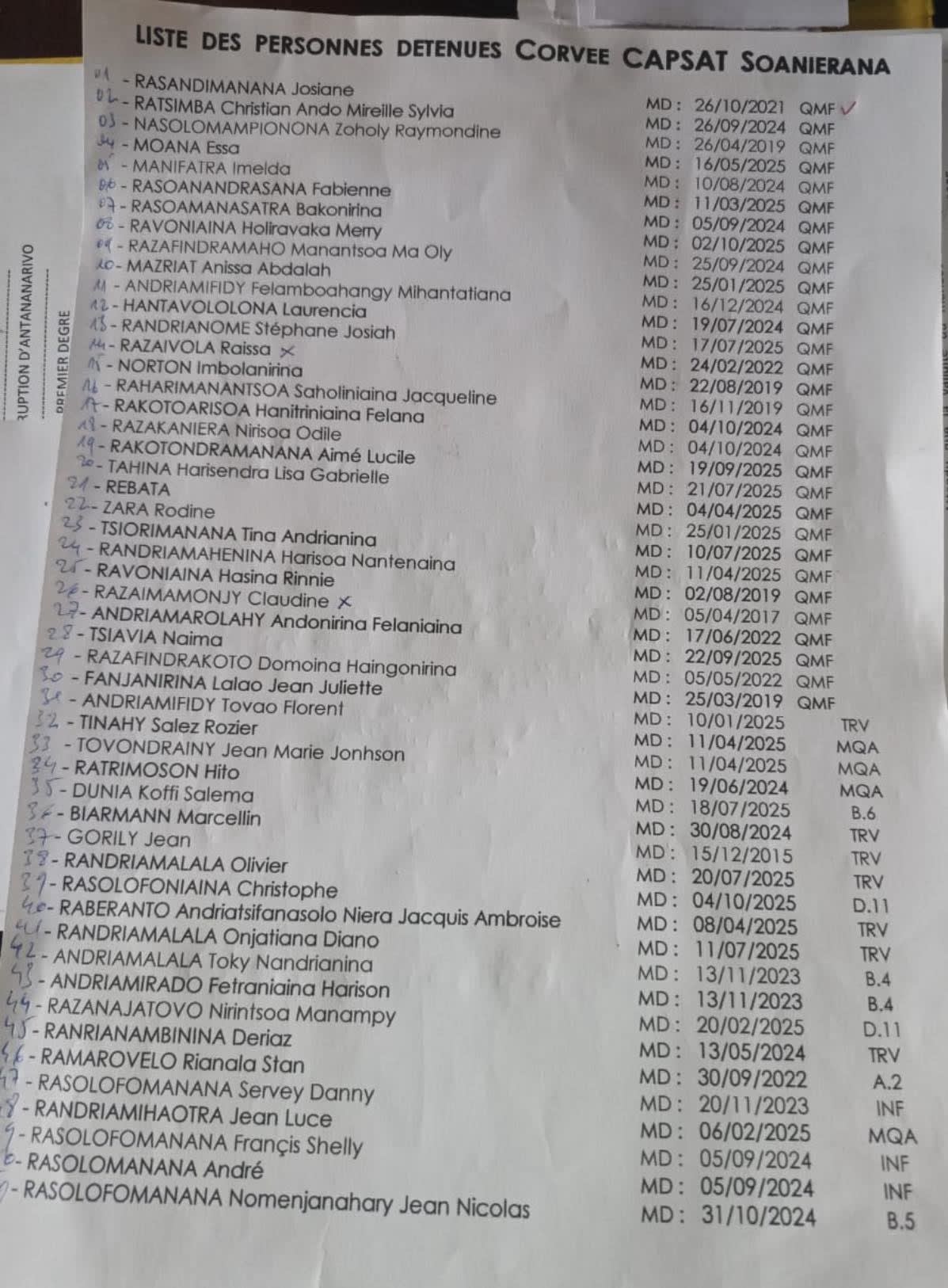
Les mesures du succès
Bref, la Refondation en cours à Madagascar ne devrait pas être jugée à l’aune de la rapidité de ses réalisations matérielles, aux kilomètres de routes ou aux inaugurations, au nombre d’actions immédiates entreprises, mais à la solidité des bases qu’elle pose pour l’avenir, à la qualité des garde-fous démocratiques qu’elle met en place : une justice indépendante, des élections crédibles, une administration responsable, un pouvoir civil respectueux du droit et des citoyens conscients de leurs devoirs.
Une Transition réussie ne se mesure pas à ce qu’elle résout, mais à ce qu’elle empêche de reproduire. Elle est celle qui rend impossible le retour aux erreurs du passé et ouvre la voie à une démocratie solide, orientée vers le développement et le bien-être du peuple. Le véritable succès de la Refondation se mesurera en définitive à la qualité du cadre institutionnel qu’elle laissera en héritage.